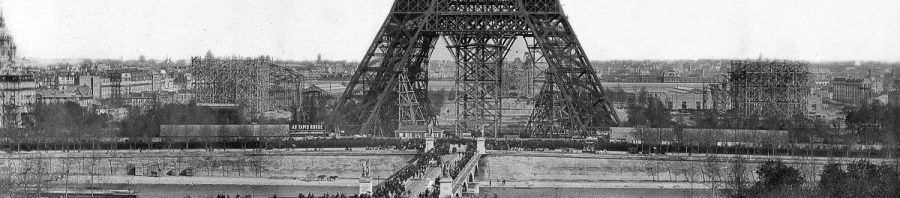Il est 18 heures, le musée se vide de ses derniers visiteurs. Je regarde une magnifique statuette pré-colombienne, mais fixe en réalité mon regard sur le reflet du gardien qui termine sa ronde, trainant le pas en espérant que je me dirige vers la sortie. Ce que je fais, avant de m’éclipser au dernier moment dans une aile fermée au public. Il ne m’a pas vu, parfait. Quelques couloirs plus loin, je retrouve mes comparses. Nous nous débarrassons de nos chapeaux, manteaux, lunettes, pour révéler nos tenues tactiques tout en noir. Chaussures anti-bruit, vêtements légers, cagoules. Nous sommes six, chacun a un rôle précis. Tandis que nos accoutrements civils sont empaquetés dans un des sacs à dos, on se refait un point rapide : nous disposons de 10 minutes exactement avant que l’équipe de nuit amorce sa ronde. Ce moment de flottement entre le départ des derniers visiteurs et la sécurité renforcée est notre fenêtre de tir. Nous regagnons la galerie principale. Sans un bruit, chacun avance vers notre objectif : une petite statuette antique de quelques centimètres de haut. Deux d’entre nous ouvrent la marche et guettent à chaque changement de salle qu’aucun gardien n’ait décidé de trainer par là. La voie est libre. Nous voilà enfin dans la bonne salle. La lumière tamisée est à notre avantage. Deux à chaque entrée, deux autour de la statuette. Percer le verre qui la protège est le rôle qui m’a été attribué. Je sors de mon sac un petit laser qui me permet d’ouvrir un cercle dans la paroi, que je retiens avec une ventouse. Mon acolyte attrape la statuette et la fourre dans son sac. Mission accomplie, il est temps de s’éclipser. Retour à notre point de départ. À pas feutrés, tapis dans l’ombre, nous glissons de salle en salle. Arrivés au fond du couloir, nous nous regroupons en cercle. « Rien à signaler ? Parés pour le départ ? » demande l’un d’entre nous. Non, rien à signaler, on est prêts. Celui qui a posé la question sort alors de son sac un boitier ; nous nous tenons tous par le bras, reliés au porteur du boîtier. Il l’active et un halo de lumière nous éclaire d’un coup : mon gardien du début, qui a décidé de faire du zèle. Il a à peine le temps de nous apercevoir que — zap — nous voici de retour chez nous, au XXIIe siècle. Mission accomplie.
« C’est ennuyeux qu’on ait été vus en plein transfert », dit l’un. « C’est rien, il croira avoir halluciné » je réponds. « Et puis c’est pour la bonne cause ». On se débarrasse de notre accoutrement de voleurs et nous dirigeons vers un bureau situé à quelques pas de la salle de transfert. Nous empruntons une passerelle extérieure. La vue est dégagée, il fait beau. Lors du cataclysme du XXIe siècle, l’espèce humaine a vu sa population drastiquement chuter. Il ne restait plus grand monde, mais suffisamment pour se rassembler et créer cette nouvelle cité, sur des bases saines. Nous ne consommons que des énergies naturelles, avons un impact minimum sur notre environnement. Tout est recyclé et recyclable, et pourtant nous utilisons des technologies ultra pointues, comme cet appareil qui nous permet de faire des allers-retours dans le temps. Nous ne l’utilisons que pour ramener des œuvres d’art et des connaissances qui, nous le savons, seront perdues dans le cataclysme. Nous nous interdisons de modifier le cours du temps, comme par exemple pour prévenir les populations de ce qui arrive. Après tout, personne ne pouvait ignorer que la permanente recherche de croissance, sur une base capitaliste, sans aucune considération écologique, mènerait à la catastrophe qui est arrivée. Tout le monde savait que le mur était droit devant et qu’ils y fonçaient à 200 à l’heure. C’est ainsi.
Une fois arrivés dans le bureau du responsable culturel pour un débriefing de la mission et surtout lui partager notre butin, il nous annonce une nouvelle mission. Cette fois, ça sera 25 ans après, pour une pièce tout juste acquise par ce même musée. Nous partons dans quelques jours, le temps de préparer notre action.
Cette deuxième mission se déroule très bien. La tactique employée est à peu près la même que la première fois. Cette fois, je suis un ouvreur, c’est moi qui explore les salles avant le groupe. La toile a été découpée, nous sommes sur le chemin du retour. Quand je tombe nez à nez avec le gardien de l’autre fois. Il a pris un peu de bide, quelques cheveux gris, mais c’est bien lui. Il n’a pas peur, moi non plus. Il lève sa lampe-torche vers moi, regarde attentivement mes yeux : « C’est vous. Comme si c’était hier ». Je suis tenté de lui répondre que pour moi c’était il y a 72 heures mais je m’abstiens. Les autres derrière moi restent tapis, figés. Ils attendent que j’agisse. Alors j’agis. Je m’approche de lui. Il se crispe mais ne bouge pas. J’avance jusqu’à être en mesure de lui attraper le bras pour le neutraliser mais il m’interpelle juste avant : « Écoutez ; je ne sais pas qui vous êtes mais je peux vous aider ». Je m’arrête. Comment ça nous aider ? Il continue : « J’ai pas l’impression que vous êtes de simples voleurs. Vous avez choisi des œuvres, pas au hasard. On dirait des collectionneurs, dans le bon sens du terme. Et quand vous avez disparus l’autre fois, j’ai cogité. Et j’en ai déduis que vous n’êtes pas d’ici… ni de maintenant ». Alors là il m’a scié, le gardien. Je décide d’être franc avec lui : « Bien raisonné. Nous mettons à l’abris des œuvres en danger. Je ne peux vous en dire plus mais c’est pour le bien commun ». Il acquiesce, baisse sa lampe torche, et se décale sur le côté, comme pour nous laisser passer. On file sans un bruit. De loin, je lui souffle un « merci » et nous disparaissons.
Lors du débrief, cet incident est débattu en longueur. La question de le ramener à notre époque est vite écartée, il n’y appartient pas et c’est contraire à nos principes. Par contre, que faire s’il parle de nous ? Alors que nous en discutons, quelqu’un surgit dans le bureau : « Un message. Du passé ». Nous avons interféré avec le passé en nous rendant visibles par un homme du XXIe siècle assez malin pour déduire qui nous sommes, et il nous a laissé un message. Une plaque de marbre, gravée, sous les décombres du musée non loin de notre cité. Il nous donne rendez-vous à une date précise, pour nous aider à sécuriser un maximum d’œuvres. Alors ça. Après un rapide tour de table, nous prenons le risque.
Nous apparaissons à la date indiquée. Il nous attendait. Le sourire aux lèvres. C’est un garde proche de la retraite que nous découvrons, l’œil excité, les jambes impatientes de s’activer. « Dépêchons, dépêchons » souffle-t-il. Il a tout préparé. Il nous guide vers la réserve en nous indiquant les œuvres qui selon lui valent d’être sauvées. Nous stockons un maximum de chose dans un coin, sélectionnant méticuleusement les œuvres. Il nous observe, mi-inquiet, mi-fier. Une fois le tour fait, nous nous rassemblons. Que fait-on de lui ? Ce casse sera le plus gros du musée, il nous a délibérément aidés, il sera emprisonné. Mais nous ne pouvons pas le ramener. Alors que nous échangeons, il se rapproche de nous. « Ne vous inquiétez pas pour moi. Je m’arrangerai avec le directeur, il me doit bien ça ». Nous partons. Nous ne le reverrons jamais, notre travail avec ce musée est terminé. Nous ne savons pas s’il vivra assez longtemps pour voir le cataclysme, mais nous espérons pour lui que non.